par Walter Benjamin
I
Il est du principe de l’œuvre d’art d’avoir toujours été reproductible. Ce que des hommes avaient fait, d’autres pouvaient toujours le refaire. Ainsi, la réplique fut pratiquée par les maîtres pour la diffusion de leurs œuvres, la copie par les élèves dans l’exercice du métier, enfin le faux par des tiers avides de gain. Par rapport à ces procédés, la reproduction mécanisée de l’œuvre d’art représente quelque chose de nouveau ; technique qui s’élabore de manière intermittente à travers l’histoire, par poussées à de longs intervalles, mais avec une intensité croissante. Avec la gravure sur bois, le dessin fut pour la première fois mécaniquement reproductible il le fut longtemps avant que l’écriture ne le devînt par l’imprimerie. Les formidables changements que l’imprimerie, reproduction mécanisée de l’écriture, a provoqué dans la littérature, sont suffisamment connus. Mais ces procédés ne représentent qu’une étape particulière, d’une portée sans doute considérable, du processus que nous analysons ici sur le plan de l’histoire universelle. La gravure sur bois du Moyen-Age, est suivie de l’estampe et de l’eau-forte, puis, au début du XIXe siècle, de la lithographie.
Avec la lithographie, la technique de reproduction atteint un plan essentiellement nouveau. Ce procédé beaucoup plus immédiat, qui distingue la réplique d’un dessin sur une pierre de son incision sur un bloc de bois ou sur une planche de cuivre, permit à l’art graphique d’écouler sur le marché ses productions, non seulement d’une manière massive comme jusques alors, mais aussi sous forme de créations toujours nouvelles. Grâce à la lithographie, le dessin fut à même d’accompagner illustrativement la vie quotidienne. Il se mit à aller de pair avec l’imprimé. Mais la lithographie en était encore à ses débuts, quand elle se vit dépassée, quelques dizaines d’années après son invention, par celle de la photographie. Pour la première fois dans les procédés reproductifs de l’image, la main se trouvait libérée des obligations artistiques les plus importantes, qui désormais incombaient à l’œil seul. Et comme l’œil perçoit plus rapidement que ne peut dessiner la main, le procédé de la reproduction de l’image se trouva accéléré à tel point qu’il put aller de pair avec la parole. De même que la lithographie contenait virtuellement le journal illustré ainsi la photographie, le film sonore. La reproduction mécanisée du son fut amorcée à la fin du siècle dernier.
Vers 1900, la reproduction mécanisée avait atteint un standard où non seulement elle commençait à faire des œuvres d’art du passé son objet et à transformer par là même leur action, mais encore atteignait à une situation autonome les procédés artistiques. Pour l’étude de ce standard, rien n’est plus révélateur que la manière dont ses deux manifestations différentes reproduction de l’œuvre d’art et art cinématographique se répercutèrent sur l’art dans sa forme traditionnelle.
II
A la reproduction même la plus perfectionnée d’une œuvre d’art, un facteur fait toujours défaut : son hic et nunc, son existence unique au lieu où elle se trouve. Sur cette existence unique, exclusivement, s’exerçait son histoire. Nous entendons par là autant les altérations qu’elle peut subir dans sa structure physique, que les conditions toujours changeantes de propriété par lesquelles elle a pu passer. La trace des premières ne saurait être relevée que par des analyses chimiques qu’il est impossible d’opérer sur la reproduction; les secondes sont l’objet d’une tradition dont la reconstitution doit prendre son point de départ au lieu même où se trouve l’original.
Le hic et nunc de l’original forme le contenu de la notion de l’authenticité, et sur cette dernière repose la représentation d’une tradition qui a transmis jusqu’à nos jours cet objet comme étant resté identique à lui-même. Les composantes de l’authenticité se refusent à toute reproduction, non pas seulement à la reproduction mécanisée. L’original, en regard de la reproduction manuelle, dont il faisait aisément apparaître le produit comme faux, conservait toute son autorité; or, cette situation privilégiée change en regard de la reproduction mécanisée.
Le motif en est double. Tout d’abord, la reproduction mécanisée s’affirme avec plus d’indépendance par rapport à l’original que la reproduction manuelle. Elle peut, par exemple en photographie, révéler des aspects de l’original accessibles non à l’œil nu, mais seulement à l’objectif réglable et libre de choisir son champ et qui, à l’aide de certains procédés tels que l’agrandissement, capte des images qui échappent à l’optique naturelle. En second lieu, la reproduction mécanisée assure à l’original l’ubiquité dont il est naturellement privé. Avant tout, elle lui permet de venir s’offrir à la perception soit sous forme de photographie, soit sous forme de disque. La cathédrale quitte son emplacement pour entrer dans le studio d’un amateur ; le chœur exécuté en plein air ou dans une salle d’audition, retentit dans une chambre.
Ces circonstances nouvelles peuvent laisser intact le contenu d’une œuvre d’art – toujours est-il qu’elles déprécient son hic et nunc. S’il est vrai que cela ne vaut pas exclusivement pour l’œuvre d’art, mais aussi pour un paysage qu’un film déroule devant le spectateur, ce processus atteint l’objet d’art – en cela bien plus vulnérable que l’objet de la nature – en son centre même : son authenticité. L’authenticité d’une chose intègre tout ce qu’elle comporte de transmissible de par son origine, sa durée matérielle comme son témoignage historique. Ce témoignage, reposant sur la matérialité, se voit remis en question par la reproduction, d’où toute matérialité s’est retirée. Sans doute seul ce témoignage est-il atteint, mais en lui l’autorité de la chose et son poids traditionnel.
On pourrait réunir tous ces indices dans la notion d’aura et dire : ce qui, dans l’œuvre d’art, à l’époque de la reproduction mécanisée, dépérit, c’est son aura. Processus symptomatique dont la signification dépasse de beaucoup le domaine de l’art.
La technique de reproduction – telle pourrait être la formule générale – détache la chose reproduite du domaine de la tradition. En multipliant sa reproduction, elle met à la place de son unique existence son existence en série et, en permettant à la reproduction de s’offrir en n’importe quelle situation au spectateur ou à l’auditeur, elle actualise la chose reproduite. Ces deux procès mènent à un puissant bouleversement de la chose transmise, bouleversement de la tradition qui n’est que le revers de la crise et du renouvellement actuel de l’humanité. Ces deux procès sont en étroit rapport avec les mouvements de masse contemporains. Leur agent le plus puissant est le film. Sa signification sociale, même considérée dans sa fonction la plus positive, ne se conçoit pas sans cette fonction destructive, cathartique : la liquidation de ia valeur traditionnelle de l’héritage culturel. Ce phénomène est particulièrement tangible dans les grands films historiques. Il intègre à son domaine des régions toujours nouvelles. Et si Abel Gance, en 1927, s’écrie avec enthousiasme : Shakespeare, Rembrandt, Beethoven feront du cinéma… Toutes les légendes, toute la mythologie et tous les mythes, tous les fondateurs de religions et toutes les religions elles-mêmes… attendent leur résurrection lumineuse, et les héros se bousculent a nos portes pour entrer [1], il convie sans s’en douter à une vaste liquidation.
III
À de grands intervalles dans l’histoire, se transforme en même temps que leur mode d’existence le mode de perception des sociétés humaines. La façon dont le mode de perception s’élabore (le médium dans lequel elle s’accomplit) n’est pas seulement déterminée par la nature humaine, mais par les circonstances historiques. L’époque de l’invasion des Barbares, durant laquelle naquirent l’industrie artistique du Bas-Empire et la Genèse de Vienne, ne connaissait pas seulement un art autre que celui de l’Antiquité, mais aussi une perception autre. Les savants de l’École viennoise, Riegl et Wickhoff, qui réhabilitèrent cet art longtemps déconsidéré sous l’influence des théories classicistes, ont les premiers eu l’idée d’en tirer des conclusions quant au mode de perception particulier à l’époque où cet art était en honneur. Quelle qu’ait été la portée de leur pénétration, elle se trouvait limitée par le fait que ces savants se contentaient de relever les caractéristiques formelles de ce mode de perception. Ils n’ont pas essayé – et peut-être ne pouvaient espérer – de montrer les bouleversements sociaux que révélaient les métamorphoses de la perception.
De nos jours, les conditions d’une recherche correspondante sont plus favorables et, si les transformations dans le médium de la perception contemporaine peuvent se comprendre comme la déchéance de l’aura, il est possible d’en indiquer les causes sociales.
Qu’est-ce en somme que l’aura ? Une singulière trame de temps et d’espace : apparition unique d’un lointain, si proche soit-il. L’homme qui, un après-midi d’été, s’abandonne à suivre du regard le profil d’un horizon de montagnes ou la ligne d’une branche qui jette sur lui son ombre – cet homme respire l’aura de ces montagnes, de cette branche. Cette expérience nous permettra de comprendre la détermination sociale de l’actuelle déchéance de l’aura. Cette déchéance est due à deux circonstances, en rapport toutes deux avec la prise de conscience accentuée des masses et l’intensité croissante de leurs mouvements. Car : la masse revendique que le monde lui soit rendu plus accessible avec autant de passion qu’elle prétend à déprécier l’unicité de tout phénomène en accueillant sa reproduction multiple. De jour en jour, le besoin s’affirme plus irrésistible de prendre possession immédiate de l’objet dans l’image, bien plus, dans sa reproduction. Aussi, telle que les journaux illustrés et les actualités filmées la tiennent à disposition se distingue-t-elle immanquablement de l’image d’art. Dans cette dernière, l’unicité et la durée sont aussi étroitement confondues que la fugacité et la reproductibilité dans le cliché.
Sortir de son halo l’objet en détruisant son aura, c’est la marque d’une perception dont le sens du semblable dans le monde se voit intensifié à tel point que, moyennant la reproduction, elle parvient à standardiser l’unique. Ainsi se manifeste dans le domaine de la réceptivité ce qui déjà, dans le domaine de la théorie, fait l’importance toujours croissante de la statistique. L’action des masses sur la réalité et de la réalité sur les masses représente un processus d’une portée illimitée, tant pour la pensée que pour la réceptivité.
IV
L’unicité de l’oeuvre d’art ne fait qu’un avec son intégration dans la tradition. Par ailleurs, cette tradition elle-même est sans doute quelque chose de fort vivant, d’extraordinairement changeant en soi. Une antique statue de Vénus était autrement située, par rapport à la tradition, chez les Grecs qui en faisaient l’objet d’un culte, que chez les clercs du Moyen-âge qui voyaient en elle une idole malfaisante. Mais aux premiers comme aux seconds elle apparaissait dans tout son caractère d’unicité, en un mot dans son aura. La forme originelle d’intégration de l’œuvre d’art dans la tradition se réalisait dans le culte. Nous savons que les oeuvres d’art les plus anciennes s’élaborèrent au service d’un rituel d’abord magique, puis religieux. Or, il est de la plus haute signification que le mode d’existence de l’oeuvre d’art déterminé par l’aura ne se sépare jamais absolument de sa fonction rituelle. En d’autres termes : la valeur unique de l’oeuvre d’art authentique a sa base dans le rituel. Ce fond rituel, si reculé soit-il, transparaît encore dans les formes les plus profanes du culte de la beauté. Ce culte, qui se développe au cours de la Renaissance, reste en honneur pendant trois siècles – au bout desquels le premier ébranlement sérieux qu’il subit décèle ce fond. Lorsqu’à l’avènement du premier mode de reproduction vraiment révolutionnaire, la photographie (simultanément avec la montée du socialisme), l’art éprouve l’approche de la crise, devenue évidente un siècle plus tard, il réagit par la doctrine de l’art pour l’art, qui n’est qu’une théologie de l’art. C’est d’elle qu’est ultérieurement issue une théologie négative sous forme de l’idée de l’art pur, qui refuse non seulement toute fonction sociale, mais encore toute détermination par n’importe quel sujet concret. (En poésie, Mallarmé fut le premier à atteindre cette position.)
Il est indispensable de tenir compte de ces circonstances historiques dans une analyse ayant pour objet l’oeuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée. Car elles annoncent cette vérité décisive : la reproduction mécanisée, pour la première fois dans l’histoire universelle, émancipe l’oeuvre d’art de son existence parasitaire dans le rituel. Dans une mesure toujours accrue, l’oeuvre d’art reproduite devient reproduction d’une oeuvre d’art destinée à la reproductibilité [2]. Un cliché photographique, par exemple, permet le tirage de quantité d’épreuves : en demander l’épreuve authentique serait absurde. Mais dès l’instant où le critère d’authenticité cesse d’être applicable à la production artistique, l’ensemble de la fonction sociale de l’art se trouve renversé. À son fond ritueldoit se substituer un fond constitué par une pratique autre : la politique.
V
Il serait possible de représenter l’histoire de l’art comme l’opposition de deux pôles de l’oeuvre d’art même, et de retracer la courbe de son évolution en suivant les déplacements du centre de gravité d’un pôle à l’autre. Ces deux pôles sont sa valeur rituelle et sa valeur d’exposition. La production artistique commence par des images au service de la magie. Leur importance tient au fait même d’exister, non au fait d’être vues. L’élan que l’homme de l’âge de la pierre dessine sur les murs de sa grotte est un instrument de magie, qu’il n’expose que par hasard à la vue d’autrui ; l’important serait tout au plus que les esprits voient cette image. La valeur rituelle exige presque que l’oeuvre d’art demeure cachée : certaines statues de dieux ne sont accessibles qu’au prêtre, certaines images de la Vierge restent voilées durant presque toute l’année, certaines sculptures des cathédrales gothiques sont invisibles au spectateur au niveau du sol. Avec l’émancipation des différents procédés d’art au sein du rituel se multiplient pour l’oeuvre d’art les occasions de s’exposer. Un buste, que l’on peut envoyer à tel ou tel endroit, est plus susceptible d’être exposé qu’une statue de dieu qui a sa place fixée dans l’enceinte du temple. Le tableau surpasse à cet égard la mosaïque ou la fresque qui le précédèrent.
Avec les différentes méthodes de reproduction de l’oeuvre d’art, son caractère d’exposabilités’est accru dans de telles proportions que le déplacement quantitatif entre les deux pôles se renverse, comme aux âges préhistoriques, en transformation qualitative de son essence. De même qu’aux âges préhistoriques, l’oeuvre d’art, par le poids absolu de sa valeur rituelle, fut en premier lieu un instrument de magie dont on n’admit que plus tard le caractère artistique, de même de nos jours, par le poids absolu de sa valeur d’exposition, elle devient une création à fonctions entièrement nouvelles – parmi lesquelles la fonction pour nous la plus familière, la fonction artistique, se distingue en ce qu’elle sera sans doute reconnue plus tard accessoire. Du moins est-il patent que le film fournit les éléments les plus probants à pareil pronostic. Il est en outre certain que la portée historique de cette transformation des fonctions de l’art, manifestement déjà fort avancée dans le film, permet la confrontation avec la préhistoire de manière non seulement méthodologique mais matérielle.
VI
L’art de la préhistoire met ses notations plastiques au service de certaines pratiques, les pratiques magiques – qu’il s’agisse de tailler la figure d’un ancêtre (cet acte étant en soi-même magique) ; d’indiquer le mode d’exécution de ces pratiques (la statue étant dans une attitude rituelle) ; ou enfin, de fournir un objet de contemplation magique (la contemplation de la statue s’effectuait selon les exigences d’une société à technique encore confondue avec le rituel). Technique naturellement arriérée en comparaison de la technique mécanique. Mais ce qui importe à la considération dialectique, ce n’est pas l’infériorité mécanique de cette technique, mais sa différence de tendance d’avec la nôtre – la première engageant l’homme autant que possible, la seconde le moins possible. L’exploit de la première, si l’on ose dire, est le sacrifice humain, celui de la seconde s’annoncerait dans l’avion sans pilote dirigé à distance par ondes hertziennes. Une fois pour toutes – ce fut la devise de la première technique (soit la faute irréparable, soit le sacrifice de la vie éternellement exemplaire). Une fois n’est rien- c’est la devise de la seconde technique (dont l’objet est de reprendre, en les variant inlassablement, ses expériences). L’origine de la seconde technique doit être cherchée dans le moment où, guidé par une ruse inconsciente, l’homme s’apprêta pour la première fois à se distancer de la nature. En d’autres termes : la seconde technique naquit dans le jeu.
Le sérieux et le jeu, la rigueur et la désinvolture se mêlent intimement dans l’oeuvre d’art, encore qu’à différents degrés. Ceci implique que l’art est solidaire de la première comme de la seconde technique. Sans doute les termes : domination des forces naturelles n’expriment-ils le but de la technique moderne que de façon fort discutable ; ils appartiennent encore au langage de la première technique. Celle-ci visait réellement à un asservissement de la nature – la seconde bien plus à une harmonie de la nature et de l’humanité. La fonction sociale décisive de l’art actuel consiste en l’initiation de l’humanité à ce jeu harmonien. Cela vaut surtout pour le film. Le film sert à exercer l’homme à la perception et à la réaction déterminées par la pratique d’un équipement technique dont le rôle dans sa vie ne cesse de croître en importance. Ce rôle lui enseignera que son asservissement momentané à cet outillage ne fera place à l’affranchissement par ce même outillage que lorsque la structure économique de l’humanité se sera adaptée aux nouvelles forces productives mises en mouvement par la seconde technique [3].
VII
Dans la photographie, la valeur d’exposition commence à refouler sur toute la ligne la valeur rituelle. Mais celle-ci ne cède pas le terrain sans résister. Elle se retire dans un ultime retranchement : la face humaine. Ce n’est point par hasard que le portrait se trouve être l’objet principal de la première photographie. Le culte du souvenir des êtres aimés, absents ou défunts, offre au sens rituel de l’oeuvre d’art un dernier refuge. Dans l’expression fugitive d’un visage humain, sur d’anciennes photographies, l’aura semble jeter un dernier éclat. C’est ce qui fait leur incomparable beauté, toute chargée de mélancolie. Mais sitôt que la figure humaine tend à disparaître de la photographie, la valeur d’exposition s’y affirme comme supérieure à la valeur rituelle. Le fait d’avoir situé ce processus dans les rues de Paris 1900, en les photographiant désertes, constitue toute l’importance des clichés d’Atget. Avec raison, on a dit qu’il les photographiait comme le lieu d’un crime. Le lieu du crime est désert. On le photographie pour y relever des indices. Dans le procès de l’histoire, les photographies d’Atget prennent la valeur de pièces à conviction. C’est ce qui leur donne une signification politique cachée. Les premières, elles exigent une compréhension dans un sens déterminé. Elles ne se prêtent plus à un regard détaché. Elles inquiètent celui qui les contemple : il sent que pour les pénétrer, il lui faut certains chemins; il a déjà suivi pareils chemins dans les journaux illustrés. De vrais ou de faux – n’importe. Ce n’est que dans ces illustrés que les légendes sont devenues obligatoires. Et il est clair qu’elles ont un tout autre caractère que les titres de tableaux. Les directives que donnent à l’amateur d’images les légendes bientôt se feront plus précises et plus impératives dans le film, où l’interprétation de chaque image est déterminée par la succession de toutes les précédentes.
VIII
Les Grecs ne connaissaient que deux procédés de reproduction mécanisée de l’oeuvre d’art : le moulage et la frappe. Les bronzes, les terracottes et les médailles étaient les seules oeuvres d’art qu’ils pussent produire en série. Tout le reste restait unique et techniquement irreproductible. Aussi ces oeuvres devaient-elles être faites pour l’éternité. Les Grecs se voyaient contraints, de par la situation même de leur technique, de créer un art de valeurs éternelles. C’est à cette circonstance qu’est due leur position exclusive dans l’histoire de l’art, qui devait servir aux générations suivantes de point de repère. Nul doute que la nôtre ne soit aux antipodes des Grecs. Jamais auparavant les oeuvres d’art ne furent à un tel degré mécaniquement reproductibles. Le film offre l’exemple d’une forme d’art dont le caractère est pour la première fois intégralement déterminé par sa reproductibilité. Il serait oiseux de comparer les particularités de cette forme à celles de l’art grec. Sur un point cependant, cette comparaison est instructive. Par le film est devenue décisive une qualité que les Grecs n’eussent sans doute admise qu’en dernier lieu ou comme la plus négligeable de l’art : la perfectibilité de l’oeuvre d’art. Un film achevé n’est rien moins qu’une création d’un seul jet ; il se compose d’une succession d’images parmi lesquelles le monteur fait son choix – images qui de la première à la dernière prise de vue avaient été à volonté retouchables. Pour monter son Opinion publique, film de 3 000 mètres, Chaplin en tourne 125 000. Le film est donc l’oeuvre d’art la plus perfectible, et cette perfectibilité procède directement de son renoncement radical à toute valeur d’éternité. Ce qui ressort de la contre-épreuve : les Grecs, dont l’art était astreint à la production de valeurs éternelles, avaient placé au sommet de la hiérarchie des arts la forme d’art la moins susceptible de perfectibilité, la sculpture, dont les productions sont littéralement tout d’une pièce. La décadence de la sculpture à l’époque des oeuvres d’art montables apparaît comme inévitable.
IX
La dispute qui s’ouvrit, au cours du XIXe siècle, entre la peinture et la photographie, quant à la valeur artistique de leurs productions respectives, apparaît de nos jours confuse et dépassée. Cela n’en diminue du reste nullement la portée, et pourrait au contraire la souligner. En fait, cette querelle était le symptôme d’un bouleversement historique de portée universelle dont ni l’une ni l’autre des deux rivales ne jugeaient toute la portée. L’ère de la reproductibilité mécanisée séparant l’art de son fondement rituel, l’apparence de son autonomie s’évanouit à jamais. Cependant le changement des fonctions de l’art qui en résultait dépassait les limites des perspectives du siècle. Et même, la signification en échappait encore au XXe siècle – qui vit la naissance du film.
Si l’on s’était auparavant dépensé en vaines subtilités pour résoudre ce problème : la photographie est-elle ou n’est-elle pas un art ? – sans s’être préalablement demandé si l’invention même de la photographie n’avait pas, du tout au tout, renversé le caractère fondamental de l’art – les théoriciens du cinéma à leur tour s’attaquèrent à cette question prématurée. Or, les difficultés que la photographie avait suscitées à l’esthétique traditionnelle n’étaient que jeux d’enfant au regard de celles que lui préparait le film. D’où l’aveuglement obstiné qui caractérise les premières théories cinématographiques. C’est ainsi qu’Abel Gance, par exemple, prétend : Nous voilà, par un prodigieux retour en arrière, revenus sur le plan d’expression des Egyptiens… Le langage des images n’est pas encore au point parce que nos yeux ne sont pas encore faits pour elles. Il n’y a pas encore assez de respect, de culte pour ce qu’elles expriment. [4]Séverin-Mars écrit : Quel art eut un rêve plus hautain, plus poétique à la fois et plus réel. Considéré ainsi, le cinématographe deviendrait un moyen d’expression tout à fait exceptionnel, et dans son atmosphère ne devraient se mouvoir que des personnages de la pensée la plus supérieure aux moments les plus parfaits et les plus mystérieux de leur course. [5]Alexandre Arnoux de son côté achevant une fantaisie sur le film muet, va même jusqu’à demander : En somme, tous les termes hasardeux que nous venons d’employer ne définissent-ils pas la prière ? [6]Il est significatif de constater combien leur désir de classer le cinéma parmi les arts, pousse ces théoriciens à faire entrer brutalement dans le film des éléments rituels. Et pourtant, à l’époque de ces spéculations, des oeuvres telles que L’Opinion publique et La Ruée vers l’or se projetaient sur tous les écrans. Ce qui n’empêche pas Gance de se servir de la comparaison des hiéroglyphes, ni Séverin-Mars de parler du film comme des peintures de Fra Angelico. Il est caractéristique qu’aujourd’hui encore des auteurs conservateurs cherchent l’importance du film, sinon dans le sacral, du moins dans le surnaturel. Commentant la réalisation du Songe d’une nuit d’été, par Reinhardt, Werfel constate que c’est sans aucun doute la stérile copie du monde extérieur avec ses rues, ses intérieurs, ses gares, ses restaurants, ses autos et ses plages qui a jusqu’à présent entravé l’essor du film vers le domaine de l’art. Le film n’a pas encore saisi son vrai sens, ses véritables possibilités… Celles-ci consistent dans sa faculté spécifique d’exprimer par des moyens naturels et avec une incomparable force de persuasion tout ce qui est féerique, merveilleux et surnaturel. [7]
X
Photographier un tableau est un mode de reproduction ; photographier un événement fictif dans un studio en est un autre. Dans le premier cas, la chose reproduite est une oeuvre d’art, sa reproduction ne l’est point. Car l’acte du photographe réglant l’objectif ne crée pas davantage une oeuvre d’art que celui du chef d’orchestre dirigeant une symphonie. Ces actes représentent tout au plus des performances artistiques. Il en va autrement de la prise de vue au studio. Ici la chose reproduite n’est déjà plus oeuvre d’art, et la reproduction l’est tout aussi peu que dans le premier cas. L’oeuvre d’art proprement dite ne s’élabore qu’au fur et à mesure que s’effectue le découpage. Découpagedont chaque partie intégrante est la reproduction d’une scène qui n’est oeuvre d’art ni par elle-même ni par la photographie. Que sont donc ces événements reproduits dans le film, s’il est clair que ce ne sont point des oeuvres d’art ?
La réponse devra tenir compte du travail particulier de l’interprète de film. Il se distingue de l’acteur de théâtre en ceci que son jeu qui sert de base à la reproduction, s’effectue, non devant un public fortuit, mais devant un comité de spécialistes qui, en qualité de directeur de production, metteur en scène, opérateur, ingénieur du son ou de l’éclairage, etc., peuvent à tout instant intervenir personnellement dans son jeu. II s’agit ici d’un indice social de grande importance. L’intervention d’un comité de spécialistes dans une performance donnée est caractéristique du travail sportif et, en général, de l’exécution d’un test. Pareille intervention détermine en fait tout le processus de la production du film. On sait que pour de nombreux passages de la bande, on tourne des variantes. Par exemple, un cri peut donner lieu à divers enregistrements. Le monteur procède alors à une sélection établissant ainsi une sorte de record. Un événement fictif tourné dans un studio se distingue donc de l’événement réel correspondant comme se distinguerait la projection d’un disque sur une piste, dans un concours sportif, de la projection du même disque au même endroit, sur la même trajectoire, si cela avait lieu pour tuer un homme. Le premier acte serait l’exécution d’un test, mais non le second.
Il est vrai que l’épreuve de test soutenue par un interprète de l’écran est d’un ordre tout à fait unique. En quoi consiste-t-elle ? À dépasser certaine limite qui restreint étroitement la valeur sociale d’épreuves de test. Nous rappellerons qu’il ne s’agit point ici d’épreuve sportive, mais uniquement d’épreuves de tests mécanisés. Le sportsman ne connaît pour ainsi dire que les tests naturels. Il se mesure aux épreuves que la nature lui fixe, non à celles d’un appareil quelconque – à quelques exceptions prés, tel Nurmi qui, dit-on, courait contre la montre. Entre-temps, le processus du travail, surtout depuis sa normalisation par le système de la chaîne, soumet tous les jours d’innombrables ouvriers à d’innombrables épreuves de tests mécanisés. Ces épreuves s’établissent automatiquement : est éliminé qui ne peut les soutenir. Par ailleurs, ces épreuves sont ouvertement pratiquées par les instituts d’orientation professionnelle.
Or, ces épreuves présentent un inconvénient considérable : à la différence des épreuves sportives, elles ne se prêtent pas à l’exposition dans la mesure désirable. C’est là, justement qu’intervient le film. Le film rend l’exécution d’un test susceptible d’être exposée en faisant de cette exposabilité même un test. Car interprète de l’écran ne joue pas devant un public, mais devant un appareil enregistreur. Le directeur de prise de vue, pourrait-on dire, occupe exactement la même place que le contrôleur du test lors de l’examen d’aptitude professionnelle. Jouer sous les feux des sunlights tout en satisfaisant aux exigences du microphone, c’est là une performance de premier ordre. S’en acquitter, c’est pour l’acteur garder toute son humanité devant les appareils enregistreurs. Pareille performance présente un immense intérêt. Car c’est sous le contrôle d’appareils que le plus grand nombre des habitants des villes, dans les comptoirs comme dans les fabriques, doivent durant la journée de travail abdiquer leur humanité. Le soir venu, ces mêmes masses remplissent les salles de cinéma pour assister à la revanche que prend pour elles l’interprète de l’écran, non seulement en affirmant son humanité (ou ce qui en tient lieu) face à l’appareil, mais en mettant ce dernier au service de son propre triomphe.
XI
Pour le film, il importe bien moins que l’interprète représente quelqu’un d’autre aux yeux du public que lui-même devant l’appareil. L’un des premiers à sentir cette métamorphose que l’épreuve de test fait subir à l’interprète fut Pirandello. Les remarques qu’il fait à ce sujet dans son roman On tourne, encore qu’elles fassent uniquement ressortir l’aspect négatif de la question, et que Pirandello ne parle que du film muet, gardent toute leur valeur. Car le film sonore n’y a rien changé d’essentiel. La chose décisive est qu’il s’agit de jouer devant un appareil dans le premier cas, devant deux dans le second. Les acteurs de cinéma, écrit Pirandello, se sentent comme en exil. En exil non seulement de la scène, mais encore d’eux-mêmes. Ils remarquent confusément, avec une sensation de dépit, d’indéfinissable vide et même de faillite, que leur corps est presque subtilisé, supprimé, privé de sa réalité, de sa vie, de sa voix, du bruit qu’il produit en se remuant, pour devenir une image muette qui tremble un instant sur l’écran et disparaît en silence… La petite machine jouera devant le public avec leurs ombres, et eux, ils doivent se contenter de jouer devant elle. [8]
Le fait pourrait aussi se caractériser comme suit : pour la première fois – et c’est là l’oeuvre du film – l’homme se trouve mis en demeure de vivre et d’agir totalement de sa propre personne, tout en renonçant du même coup à son aura. Car l’aura dépend de son hic et nunc. Il n’en existe nulle reproduction, nulle réplique. L’aura qui, sur la scène, émane de Macbeth, le public l’éprouve nécessairement comme celui de l’acteur jouant ce rôle. La singularité de la prise de vues au studio tient à ce que l’appareil se substitue au public. Avec le public disparaît l’aura qui environne l’interprète et avec celui de l’interprète l’aura de son personnage.
Rien d’étonnant à ce qu’un dramaturge tel que Pirandello, en caractérisant l’interprète de l’écran, touche involontairement au fond même de la crise dont nous voyons le théâtre atteint. À l’oeuvre exclusivement conçue pour la technique de reproduction telle que le film ne saurait en effet s’opposer rien de plus décisif que l’oeuvre scénique. Toute considération plus approfondie le confirme. Les observateurs spécialisés ont depuis longtemps reconnu que c’est presque toujours en jouant le moins possible que l’on obtient les plus puissants effets cinématographiques… . Dès 1932, Arnheim considère comme dernier progrès du film de n’y tenir l’acteur que pour un accessoire choisi en raison de ses caractéristiques… et que l’on intercale au bon endroit [9]. À cela se rattache étroitement autre chose. L ‘acteur de scène s’identifie au caractère de son rôle. L’interprète d’écran n ‘en a pas toujours la possibilité. Sa création n’est nullement tout d’une pièce ; elle se compose de nombreuses créations distinctes. A part certaines circonstances fortuites telles que la location du studio, le choix et la mobilisation des partenaires, la confection des décors et autres accessoires, ce sont d’élémentaires nécessités de machinerie qui décomposent le jeu de l’acteur en une série de créations montables. II s’agit avant tout de l’éclairage dont l’installation oblige à filmer un événement qui, sur l’écran, se déroulera en une scène rapide et unique, en une suite de prises de vues distinctes qui peuvent parfois se prolonger des heures durant au studio. Sans même parler de truquages plus frappants. Si un saut, du haut d’une fenêtre à l’écran, peut fort bien s’effectuer au studio du haut d’un échafaudage, la scène de la fuite qui succède au saut ne se tournera, au besoin, que plusieurs semaines plus tard au cours des prises d’extérieurs. Au reste, l’on reconstitue aisément des cas encore plus paradoxaux. Admettons que l’interprète doive sursauter après des coups frappés à une porte. Ce sursaut n’est-il pas réalisé à souhait, le metteur en scène peut recourir à quelque expédient : profiter d’une présence occasionnelle de l’interprète au studio pour faire éclater un coup de feu. L’effroi vécu, spontané de l’interprète, enregistré à son insu, pourra s’intercaler dans la bande. Rien ne montre avec tant de plasticité que l’art s’est échappé du domaine de la belle apparence, qui longtemps passa pour le seul où il pût prospérer.
XII
Dans la représentation de l’image de l’homme par l’appareil, l’aliénation de l’homme par lui-même trouve une utilisation hautement productive. On en mesurera toute l’étendue au fait que le sentiment d’étrangeté de l’interprète devant l’objectif, décrit par Pirandello, est de même origine que le sentiment d’étrangeté de l’homme devant son image dans le miroir – sentiment que les romantiques aimaient à pénétrer. Or, désormais cette image réfléchie de l’homme devient séparable de lui, transportable et où ? Devant la masse. Évidemment, l’interprète de l’écran ne cesse pas un instant d’en avoir conscience. Durant qu’il se tient devant l’objectif, il sait qu’il aura à faire en dernière instance à la masse des spectateurs. Ce marché que constitue la masse, où il viendra offrir non seulement sa puissance de travail, mais encore son physique, il lui est aussi impossible de se le représenter que pour un article d’usine. Cette circonstance ne contribuerait-elle pas, comme l’a remarqué Pirandello, à cette oppression, à cette angoisse nouvelle qui l’étreint devant l’objectif ? À cette nouvelle angoisse correspond, comme de juste, un triomphe nouveau : celui de la star. Favorisé par le capital du film, le culte de la vedette conserve ce charme de la personnalité qui depuis longtemps n’est que le faux rayonnement de son essence mercantile. Ce culte trouve son complément dans le culte du public, culte qui favorise la mentalité corrompue de masse que les régimes autoritaires cherchent à substituer à sa conscience de classe. Si tout se conformait au capital cinématographique, le processus s’arrêterait à l’aliénation de soi-même, chez l’artiste de l’écran comme chez les spectateurs. Mais la technique du film prévient cet arrêt : elle prépare le renversement dialectique.
XIII
Il appartient à la technique du film comme à celle du sport que tout homme assiste plus ou moins en connaisseur à leurs exhibitions. Pour s’en rendre compte, il suffit d’entendre un groupe de jeunes porteurs de journaux appuyés sur leurs bicyclettes, commenter les résultats de quelque course cycliste ; en ce qui concerne le film, les actualités prouvent assez nettement qu’un chacun peut se trouver filmé. Mais la question n’est pas la. Chaque homme aujourd’hui a le droit d’être filmé. Ce droit, la situation historique de la vie littéraire actuelle permettrait de le comprendre.
Durant des siècles, les conditions déterminantes de la vie littéraire affrontaient un petit nombre d’écrivains à des milliers de lecteurs. La fin du siècle dernier vit se produire un changement. Avec l’extension croissante de la presse, qui ne cessait de mettre de nouveaux organes politiques, religieux, scientifiques, professionnels et locaux à la disposition des lecteurs, un nombre toujours plus grand de ceux-ci se trouvèrent engagés occasionnellement dans la littérature. Cela débuta avec les boîtes aux lettresque la presse quotidienne ouvrit à ses lecteurs – si bien que, de nos jours, il n’y a guère de travailleur européen qui ne se trouve à même de publier quelque part ses observations personnelles sur le travail sous forme de reportage ou n’importe quoi de cet ordre. La différence entre auteur et public tend ainsi à perdre son caractère fondamental. Elle n’est plus que fonctionnelle, elle peut varier d’un cas à l’autre. Le lecteur est à tout moment prêt à passer écrivain. En qualité de spécialiste qu’il a dû tant bien que mal devenir dans un processus de travail différencié à l’extrême – et le fût-il d’un infime emploi – il peut à tout moment acquérir la qualité d’auteur. Le travail lui-même prend la parole. Et sa représentation par le mot fait partie intégrante du pouvoir nécessaire à son exécution. Les compétences littéraires ne se fondent plus sur une formation spécialisée, mais sur une polytechnique et deviennent par là bien commun.
Tout cela vaut également pour le film, où les décalages qui avaient mis des siècles à se produire dans la vie littéraire se sont effectués au cours d’une dizaine d’années. Car dans la pratique cinématographique – et surtout dans la pratique russe – ce décalage s’est en partie déjà réalisé. Un certain nombre d’interprètes des films soviétiques ne sont point des acteurs au sens occidental du mot, mais des hommes jouant leur propre rôle – tout premièrement leur rôle dans le processus du travail. En Europe occidentale, l’exploitation du film par le capital cinématographique interdit à l’homme de faire valoir son droit à se montrer dans ce rôle. Au reste, le chômage l’interdit également, qui exclut de grandes masses de la production dans le processus de laquelle elles trouveraient surtout un droit à se voir reproduites. Dans ces conditions, l’industrie cinématographique a tout intérêt à stimuler la masse par des représentations illusoires et des spéculations équivoques. À cette fin, elle a mis en branle un puissant appareil publicitaire : elle a tiré parti de la carrière et de la vie amoureuse des stars, elle a organisé des plébiscites et des concours de beauté. Elle exploite ainsi un élément dialectique de formation de la masse. L’aspiration de l’individu isolé à se mettre à la place de la star, c’est-à-dire à se dégager de la masse, est précisément ce qui agglomère les masses spectatrices des projections. C’est de cet intérêt tout privé que joue l’industrie cinématographique pour corrompre l’intérêt originel justifié des masses pour le film.
XIV
La prise de vues et surtout l’enregistrement d’un film offrent une sorte de spectacle telle qu’on n’en avait jamais vue auparavant. Spectacle qu’on ne saurait regarder d’un point quelconque sans que tous les auxiliaires étrangers à la mise en scène même – appareils d’enregistrement, d’éclairage, état-major d’assistants – ne tombent dans le champ visuel (à moins que la pupille du spectateur fortuit ne coïncide avec l’objectif). Ce simple fait suffit seul à rendre superficielle et vaine toute comparaison entre enregistrement au studio et répétition théâtrale. De par son principe, le théâtre connaît le point d’où l’illusion de l’action ne peut être détruite. Ce point n’existe pas vis-à-vis de la scène de film qu’on enregistre. La nature illusionniste du film est une nature au second degré – résultat du découpage. Ce qui veut dire : au studio l’équipement technique a si profondément pénétré la réalité que celle-ci n’apparaît dans le film dépouillée de l’outillage que grâce à une procédure particulière – à savoir l’angle de prise de vues par la caméra et le montage de cette prise avec d’autres de même ordre.
Dans le monde du film la réalité n’apparaît dépouillée des appareils que par le plus grand des artifices et la réalité immédiates’y présente comme la fleur bleue au pays de la Technique.
Ces données, ainsi bien distinctes de celles du théâtre, peuvent être confrontées de manière encore plus révélatrice avec celles de la peinture. II nous faut ici poser cette question : quelle est la situation de l’opérateur par rapport au peintre ? Pour y répondre, nous nous permettrons de tirer parti de la notion d’opérateur, usuelle en chirurgie. Or, le chirurgien se tient à l’un des pôles d’un univers dont l’autre est occupé par le magicien. Le comportement du magicien qui guérit un malade par imposition des mains diffère de celui du chirurgien qui procède à une intervention dans le corps du malade. Le magicien maintient la distance naturelle entre le patient et lui ou, plus exactement, s’il ne la diminue – par l’imposition des mains – que très peu, il l’augmente – par son autorité – de beaucoup. Le chirurgien fait exactement l’inverse : il diminue de beaucoup la distance entre lui et le patient – en pénétrant à l’intérieur du corps de celui-ci – et ne l’augmente que de peu – par la circonspection avec laquelle se meut sa main parmi les organes. Bref, à la différence du mage (dont le caractère est encore inhérent au praticien), le chirurgien s’abstient au moment décisif d’adopter le comportement d’homme à homme vis-à-vis du malade : c’est opératoirement qu’il le pénètre plutôt.
Le peintre est à l’opérateur ce qu’est le mage au chirurgien. Le peintre conserve dans son travail une distance normale vis-à-vis de la réalité de son sujet – par contre le cameraman pénètre profondément les tissus de la réalité donnée. Les images obtenues par l’un et par l’autre résultent de procès absolument différents. L’image du peintre est totale, celle du cameraman faite de fragments multiples coordonnés selon une loi nouvelle.
C’est ainsi que, de ces deux modes de représentation de la réalité – la peinture et le film – le dernier est pour l’homme actuel incomparablement le plus significatif, parce qu’il obtient de la réalité un aspect dépouillé de tout appareil – aspect que l’homme est en droit d’attendre de l’oeuvre d’art précisément grâce à une pénétration intensive du réelpar les appareils.
XV
La reproduction mécanisée de l’oeuvre d’art modifie la façon de réagir de la masse vis-à-vis de l’art. De rétrograde qu’elle se montre devant un Picasso par exemple, elle se fait le public le plus progressiste en face d’un Chaplin. Ajoutons que, dans tout comportement progressiste, le plaisir émotionnel et spectaculaire se confond immédiatement et intimement avec l’attitude de l’expert. C’est là un indice social important. Car plus l’importance sociale d’un art diminue, plus s’affirme dans le public le divorce entre l’attitude critique et le plaisir pur et simple. On goûte sans critiquer le conventionnel – on critique avec dégoût le véritablement nouveau. Il n’en est pas de même au cinéma. La circonstance décisive y est en effet celle-ci : les réactions des individus isolés, dont la somme constitue la réaction massive du public, ne se montrent nulle part ailleurs plus qu’au cinéma déterminées par leur multiplication imminente. Tout en se manifestant, ces réactions se contrôlent. Ici, la comparaison à la peinture s’impose une fois de plus. Jadis, le tableau n’avait pu s’offrir qu’à la contemplation d’un seul ou de quelques-uns. La contemplation simultanée de tableaux par un grand public, telle qu’elle s’annonce au XIXe siècle, est un symptôme précoce de la crise de la peinture, qui ne fut point exclusivement provoquée par la photographie mais, d’une manière relativement indépendante de celle-ci, par la tendance de l’oeuvre d’art à rallier les masses.
En fait, le tableau n’a jamais pu devenir l’objet d’une réception collective,ainsi que ce fut le cas de tout temps pour l’architecture, jadis pour le poème épique, aujourd’hui pour le film. Et, si peu que cette circonstance puisse se prêter à des conclusions quant au rôle social de la peinture, elle n’en représente pas moins une lourde entrave à un moment où le tableau, dans les conditions en quelque sorte contraires à sa nature, se voit directement confronté avec les masses. Dans les églises et les monastères du Moyen-Age, ainsi que dans les cours des princes jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la réception collective des oeuvres picturales ne s’effectuait pas simultanément sur une échelle égale, mais par une entremise infiniment graduée et hiérarchisée. Le changement qui s’est produit depuis n’exprime que le conflit particulier dans lequel la peinture s’est vue impliquée par la reproduction mécanisée du tableau. Encore qu’on entreprît de l’exposer dans les galeries et les salons, la masse ne pouvait guère s’y contrôler et s’organiser comme le fait, à la faveur de ses réactions, le public du cinéma. Aussi le même public qui réagit dans un esprit progressiste devant un film burlesque, doit-il nécessairement réagir dans un esprit rétrograde en face de n’importe quelle production du surréalisme.
XVI
Parmi les fonctions sociales du film, la plus importante consiste à établir l’équilibre entre l’homme et l’équipement technique. Cette tâche, le film ne l’accomplit pas seulement par la manière dont l’homme peut s’offrir aux appareils, mais aussi par la manière dont il peut à l’aide de ses appareils se représenter le monde environnant. Si le film, en relevant par ses gros plans dans l’inventaire du monde extérieur des détails généralement cachés d’accessoires familiers, en explorant des milieux banals sous la direction géniale de l’objectif, étend d’une part notre compréhension aux mille déterminations dont dépend notre existence, il parvient d’autre part à nous ouvrir un champ d’action immense et insoupçonné.
Nos bistros et nos avenues de métropoles, nos bureaux et chambres meublées, nos gares et nos usines paraissaient devoir nous enfermer sans espoir d’y échapper jamais. Vint le film, qui fit sauter ce monde-prison par la dynamite des dixièmes de seconde, si bien que désormais, au milieu de ses ruines et débris au loin projetés, nous faisons insoucieusement d’aventureux voyages.Sous la prise de vues à gros plan s’étend l’espace, sous le temps de pose se développe le mouvement. De même que dans l’agrandissement il s’agit bien moins de rendre simplement précis ce qui sans cela garderait un aspect vague que de mettre en évidence des formations structurelles entièrement nouvelles de la matière, il s’agit moins de rendre par le temps de pose des motifs de mouvement que de déceler plutôt dans ces mouvements connus, au moyen du ralenti, des mouvements inconnus qui, loin de représenter des ralentissements de mouvements rapides, font l’effet de mouvements singulièrement glissants, aériens, surnaturels. [10]
Il devient ainsi tangible que la nature qui parle à la caméra, est autre que celle qui parle aux yeux. Autre surtout en ce sens qu’à un espace consciemment exploré par l’homme se substitue un espace qu’il a inconsciemment pénétré. S’il n’y a rien que d’ordinaire au fait de se rendre compte, d’une manière plus ou moins sommaire, de la démarche d’un homme, on ne sait encore rien de son maintien dans la fraction de seconde d’une enjambée. Le geste de saisir le briquet ou la cuiller nous est-il aussi conscient que familier, nous ne savons néanmoins rien de ce qui se passe alors entre la main et le métal, sans parler même des fluctuations dont ce processus inconnu peut être susceptible en raison de nos diverses dispositions psychiques. C’est ici qu’intervient la caméra avec tous ses moyens auxiliaires, ses chutes et ses ascensions, ses interruptions et ses isolements, ses extensions et ses accélérations, ses agrandissements et ses rapetissements. C’est elle qui nous initie à l’inconscient optique comme la psychanalyse à l’inconscient pulsionnel.
Au reste, les rapports les plus étroits existent entre ces deux formes de l’inconscient, car les multiples aspects que l’appareil enregistreur peut dérober à la réalité se trouvent pour une grande part exclusivement en dehors du spectre normal de la perception sensorielle. Nombre des altérations et stéréotypes, des transformations et des catastrophes que le monde visible peut subir dans le film l’affectent réellement dans les psychoses, les hallucinations et les rêves. Les déformations de la caméra sont autant de procédés grâce auxquels la perception collectives’approprie les modes de perception du psychopathe et du rêveur. Ainsi, dans l’antique vérité hératiclienne – les hommes à l’état de veille ont un seul monde commun à tous, mais pendant le sommeil chacun retourne à son propre monde – le film a fait une brèche, et notamment moins par des représentations du monde onirique que par la création de figures puisées dans le rêve collectif, telles que Mickey Mouse, faisant vertigineusement le tour du globe.
Si l’on se rend compte des dangereuses tensions que la technique rationnelle a engendrées au sein de l’économie capitaliste devenue depuis longtemps irrationnelle, on reconnaîtra par ailleurs que cette même technique a créé, contre certaines psychoses collectives, des moyens d’immunisation, à savoir certains films. Ceux-ci, parce qu’ils présentent des fantasmes sadiques et des images délirantes masochistes de manière artificiellement forcée, préviennent la maturation naturelle de ces troubles dans les masses, particulièrement exposées en raison des formes actuelles de l’économie. L’hilarité collective représente l’explosion prématurée et salutaire de pareilles psychoses collectives. Les énormes quantités d’incidents grotesques qui sont consommées dans le film sont un indice frappant des dangers qui menacent l’humanité du fond des pulsions refoulées par la civilisation actuelle. Les films burlesques américains et les bandes de Disney déclenchent un dynamitage de l’inconscient. [11]Leur précurseur avait été l’excentrique. Dans les nouveaux champs ouverts par le film, il avait été le premier à s’installer. C’est ici que se situe la figure historique de Chaplin.
XVII
L’une des tâches les plus importantes de l’art a été de tout temps d’engendrer une demande dont l’entière satisfaction devait se produire à plus ou moins longue échéance. L’histoire de toute forme d’art connaît des époques critiques où cette forme aspire à des effets qui ne peuvent s’obtenir sans contrainte qu’à base d’un standard technique transformé, c’est-à-dire dans une forme d’art nouvelle. Les extravagances et les crudités de l’art, qui se produisent ainsi particulièrement dans les soi-disant époques décadentes, surgissent en réalité de son foyer créateur le plus riche. De pareils barbarismes ont en de pareilles heures fait la joie du dadaïsme. Ce n’est qu’à présent que son impulsion devient déterminable : le dadaïsme essaya d’engendrer, par des moyens picturaux et littéraires, les effets que le public cherche aujourd’hui dans le film.
Toute création de demande foncièrement nouvelle, grosse de conséquences, portera au-delà de son but. C’est ce qui se produisait pour les dadaistes, au point qu’ils sacrifiaient les valeurs négociables, exploitées avec tant de succès par le cinéma, en obéissant à des instances dont, bien entendu, ils ne se rendaient pas compte. Les dadaïstes s’appuyèrent beaucoup moins sur l’utilité mercantile de leurs oeuvres que sur l’impropriété de celles-ci au recueillement contemplatif. Pour atteindre a cette impropriété, la dégradation préméditée de leur matériel ne fut pas leur moindre moyen. Leurs poèmes sont, comme disent les psychiatres allemands, des salades de mots, faites de tournures obscènes et de tous les déchets imaginables du langage. II en est de même de leurs tableaux, sur lesquels ils ajustaient des boutons et des tickets. Ce qu’ils obtinrent par de pareils moyens, fut une impitoyable destruction de l’aura même de leurs créations, auxquelles ils appliquaient, avec les moyens de la production, la marque infamante de la reproduction. Il est impossible, devant un tableau d’Arp ou un poème d’August Stramm, de prendre le temps de se recueillir et d’apprécier comme en face d’une toile de Derain ou d’un poème de Rilke. Au recueillement qui, dans la déchéance de la bourgeoisie, devint un exercice de comportement asocial [12], s’oppose la distraction en tant qu’initiation à de nouveaux modes d’attitude sociale. Aussi, les manifestations dadaïstes assurèrent-elles une distraction fort véhémente en faisant de l’oeuvre d’art le centre d’un scandale. Il s’agissait avant tout de satisfaire à cette exigence : provoquer un outrage public.
De tentation pour l’oeil ou de séduction pour l’oreille que l’oeuvre était auparavant, elle devint projectile chez les dadaïstes. Spectateur ou lecteur, on en était atteint. L’oeuvre d’art acquit une qualité traumatique. Elle a ainsi favorisé la demande de films, dont l’élément distrayant est également en première ligne traumatisant, basé qu’il est sur les changements de lieu et de plan qui assaillent le spectateur par à-coups. Que l’on compare la toile sur laquelle se déroule le film à la toile du tableau ; l’image sur la première se transforme, mais non l’image sur la seconde. Cette dernière invite le spectateur à la contemplation. Devant elle, il peut s’abandonner à ses associations. I1 ne le peut devant une prise de vue. À peine son oeil l’a-t-elle saisi que déjà elle s’est métamorphosée. Elle ne saurait être fixée. Duhamel, qui déteste le film, mais non sans avoir saisi quelques éléments de sa structure, commente ainsi cette circonstance : Je ne peux déjà plus penser ce que je veux. Les images mouvantes se substituent à mes propres pensées. [13]
En fait, le processus d’association de celui qui contemple ces images est aussitôt interrompu par leurs transformations. C’est ce qui constitue le choc traumatisant du film qui, comme tout traumatisme, demande à être amorti par une attention soutenue. [14]Par son mécanisme même, le film a rendu leur caractère physique aux traumatismes moraux pratiqués par le dadaïsme.
XVIII
La masse est la matrice où, à l’heure actuelle, s’engendre l’attitude nouvelle vis-à-vis de l’oeuvre d’art. La quantité se transmue en qualité : les masses beaucoup plus grandes de participants ont produit un mode transformé de participation.Le fait que ce mode se présente d’abord sous une forme décriée ne doit pas induire en erreur et, cependant, il n’en a pas manqué pour s’en prendre avec passion à cet aspect superficiel du problème. Parmi ceux-ci, Duhamel s’est exprimé de la manière la plus radicale. Le principal grief qu’il fait au film est le mode de participation qu’il suscite chez les masses. Duhamel voit dans le film un divertissement d’îlotes, un passe-temps d’illettrés, de créatures misérables, ahuris par leur besogne et leurs soucis…, un spectacle qui ne demande aucun effort, qui ne suppose aucune suite dans les idées…, n’éveille au fond des coeurs aucune lumière, n’excite aucune espérance, sinon celle, ridicule d’être un jour « star » à Los-Angeles. [15]
On le voit, c’est au fond toujours la vieille plainte que les masses ne cherchent qu’à se distraire, alors que l’art exige le recueillement. C’est là un lieu commun. Reste à savoir s’il est apte à résoudre le problème. Celui qui se recueille devant l’oeuvre d’art s’y plonge : il y pénètre comme ce peintre chinois qui disparut dans le pavillon peint sur le fond de son paysage. Par contre, la masse, de par sa distraction même, recueille l’oeuvre d’art dans son sein, elle lui transmet son rythme de vie, elle l’embrasse de ses flots. L’architecture en est un exemple des plus saisissants. De tout temps elle offrit le prototype d’un art dont la réception réservée à la collectivité s’effectuait dans la distraction. Les lois de cette réception sont des plus révélatrices.
Les architectures ont accompagné l’humanité depuis ses origines. Nombre de genres d’art se sont élaborés pour s’évanouir. La tragédie naît avec les Grecs pour s’éteindre avec eux ; seules les règles en ressuscitèrent, des siècles plus tard. Le poème épique, dont l’origine remonte à l’enfance des peuples, s’évanouit en Europe au sortir de la Renaissance. Le tableau est une création du Moyen Âge, et rien ne semble garantir à ce mode de peinture une durée illimitée. Par contre, le besoin humain de se loger demeure constant. L’architecture n’a jamais chômé. Son histoire est plus ancienne que celle de n’importe quel art, et il est utile de tenir compte toujours de son genre d’influence quand on veut comprendre le rapport des masses avec l’art. Les constructions architecturales sont l’objet d’un double mode de réception : l’usage et la perception, ou mieux encore : le toucher et la vue. On ne saurait juger exactement la réception de l’architecture en songeant au recueillement des voyageurs devant les édifices célèbres. Car il n’existe rien dans la perception tactile qui corresponde à ce qu’est la contemplation dans la perception optique. La réception tactile s’effectue moins par la voie de l’attention que par celle de l’habitude. En ce qui concerne l’architecture, l’habitude détermine dans une large mesure même la réception optique. Elle aussi, de par son essence, se produit bien moins dans une attention soutenue que dans une impression fortuite. Or, ce mode de réception, élaboré au contact de l’architecture, a dans certaines circonstances acquis une valeur canonique. Car : les tâches qui, aux tournants de l’histoire, ont été imposées à la perception humaine ne sauraient guère être résolues par la simple optique, c’est-à-dire la contemplation. Elles ne sont que progressivement surmontées par l’habitude d’une optique approximativement tactile.
S’habituer, le distrait le peut aussi. Bien plus : ce n’est que lorsque nous surmontons certaines tâches dans la distraction que nous sommes sûrs de les résoudre par l’habitude. Au moyen de la distraction qu’il est à même de nous offrir, l’art établit à notre insu jusqu’à quel point de nouvelles taches de la perception sont devenues solubles. Et comme, pour l’individu isolé, la tentation subsiste toujours de se soustraire à de pareilles tâches, l’art saura s’attaquer aux plus difficiles et aux plus importantes toutes les fois qu’il pourra mobiliser des masses. Il le fait actuellement par le film. La réception dans la distraction, qui s’affirme avec une croissante intensité dans tous les domaines de l’art et représente le symptôme de profondes transformations de la perception, a trouvé dans le film son propre champ d’expérience. Le film s’avère ainsi l’objet actuellement le plus important de cette science de la perception que les Grecs avaient nommée l’esthétique.
XIX
La prolétarisation croissante de l’homme d’aujourd’hui, ainsi que la formation croissante de masses, ne sont que les deux aspects du même phénomène. L’État totalitaire essaye d’organiser les masses prolétarisées nouvellement constituées, sans toucher aux conditions de propriété, à l’abolition desquelles tendent ces masses. Il voit son salut dans le fait de permettre à ces masses l’expression de leur nature, non pas certes celle de leurs droits. [16]Les masses tendent à la transformation des conditions de propriété. L’État totalitaire cherche à donner une expression à cette tendance tout en maintenant les conditions de propriété. En d’autres termes : l’État totalitaire aboutit nécessairement à une esthétisation de la vie politique. Tous les efforts d’esthétisation politique culminent en un point. Ce point, c’est la guerre moderne. La guerre, et rien que la guerre permet de fixer un but aux mouvements de masses les plus vastes, en conservant les conditions de propriété. Voilà comment se présente l’état de choses du point de vue politique. Du point de vue technique, il se présenterait ainsi : seule la guerre permet de mobiliser la totalité des moyens techniques de l’époque actuelle en maintenant les conditions de propriété. Il est évident que l’apothéose de la guerre par l’état totalitaire ne se sert pas de pareils arguments, et cependant il sera profitable d’y jeter un coup d’oeil. Dans le manifeste de Marinetti sur la guerre italo-éthiopienne, il est dit : Depuis vingt-sept ans, nous autres futuristes nous nous élevons contre l’affirmation que la guerre n’est pas esthétique… Aussi sommes-nous amenés à constater… La guerre est belle, parce que grâce aux masques à gaz, aux terrifiants mégaphones, aux lance-flammes et aux petits tanks, elle fonde la suprématie de L’homme sur la machine subjuguée. La guerre est belle, parce qu’elle inaugure la métallisation rêvée du corps humain. La guerre est belle, parce qu’elle enrichit un pré fleuri des flamboyantes orchidées des mitrailleuses. La guerre est belle, parce qu’elle unit les coups de fusils, les canonnades, les pauses du feu, les parfums et les odeurs de la décomposition dans une symphonie. La guerre est belle, parce qu’elle crée de nouvelles architectures telle celle des grands tanks, des escadres géométriques d’avions, des spirales de fumée s’élevant des villages en flammes, et beaucoup d’autres choses encore… Poètes et artistes du Futurisme… souvenez-vous de ces principes d’une esthétique de la guerre, afin que votre lutte pour une poésie et une plastique nouvelle… en soit éclairée !
Ce manifeste a l’avantage de la netteté. Sa façon de poser la question mérite d’être adoptée par le dialecticien. À ses yeux, l’esthétique de la guerre contemporaine se présente de la manière suivante. Lorsque l’utilisation naturelle des forces de production est retardée et refoulée par l’ordre de la propriété, l’intensification de la technique, des rythmes de la vie, des générateurs d’énergie tend à une utilisation contre-nature. Elle la trouve dans la guerre, qui par ses destructions vient prouver que la société n’était pas mûre pour faire de la technique son organe, que la technique n’était pas assez développée pour juguler les forces sociales élémentaires. La guerre moderne, dans ses traits les plus immondes, est déterminée par le décalage entre les puissants moyens de production et leur utilisation insuffisante dans le processus de la production (en d’autres termes, par le chômage et le manque de débouchés).
Dans cette guerre, la technique insurgée pour avoir été frustrée par la société de son matériel naturel extorque des dommages-intérets au matériel humain. Au lieu de canaliser des cours d’eau, elle remplit ses tranchées de flots humains. Au lieu d’ensemencer la terre du haut de ses avions, elle y sème l’incendie. Et dans ses laboratoires chimiques elle a trouvé un procédé nouveau et immédiat pour supprimer l’aura.
Fiat ars, pereat mundus, dit la théorie totalitaire de l’état qui, de l’aveu de Marinetti, attend de la guerre la saturation artistique de la perception transformée par la technique. C’est apparemment là le parachèvement de l’art pour l’art. L’humanité, qui jadis avec Homère avait été objet de contemplation pour les dieux olympiens, l’est maintenant devenue pour elle-même. Son aliénation d’elle-même par elle-même a atteint ce degré qui lui fait vivre sa propre destruction comme une sensation esthétique de tout premier ordre. Voilà où en est l’esthétisation de la politique perpétrée par les doctrines totalitaires. Les forces constructives de l’humanité y répondent par la politisation de l’art.
Notes
[1]Abel GANCE : Le Temps de l’image est venu: L’art cinématographique, II, Paris, 1927. pp. 94-96).
[2]Pour les films, la reproductibilité ne dépend pas, comme pour les créations littéraires et picturales, d’une condition extérieure à leur diffusion massive. La reproductibilité mécanisée des films est inhérente à la technique même de leur production. Cette technique, non seulement permet la diffusion massive de la manière la plus immédiate, mais la détermine bien plutôt. Elle la détermine du fait même que la production d’un film exige de tels frais que l’individu, s’il peut encore se payer un tableau, ne pourra jamais s’offrir un film. En 1927, on a pu établir que, pour couvrir tous ses frais, un grand film devait disposer d’un public de neuf millions de spectateurs. Il est vrai que la création du film sonore a d’abord amené un recul de la diffusion internationale – son public s’arrêtant à la frontière des langues. Cela coïncida avec la revendication d’intérêts nationaux par les régimes autoritaires. Aussi est-il plus important d’insister sur ce rapport évident avec les pratiques des régimes autoritaires, que sur les restrictions résultant de la langue mais bientôt levées par la synchronisation. La simultanéité des deux phénomènes procède de la crise économique. Les mêmes troubles qui, sur le plan général, ont abouti à la tentative de maintenir par la force les conditions de propriété, ont déterminé les capitaux des producteurs à hâter l’élaboration du film sonore. L’avénement de ce dernier amena une détente passagère, non seulement parce que le film sonore se créa un nouveau public, mais parce qu’il rendit de nouveaux capitaux de l’industrie électrique solidaires des capitaux de production cinématographique. Ainsi, considéré de l’extérieur, le film sonore a favorisé les intérêts nationaux, mais, vu de l’intérieur, il a contribué à internationaliser la production du film encore davantage que ses conditions antérieures de production.
[3]Le but même des révolutions est d’accélérer cette adaptation. Les révolutions sont les innervations de l’élément collectif ou, plus exactement, les tentatives d’innervation de la collectivité qui pour la première fois trouve ses organes dans la seconde technique. Cette technique constitue un système qui exige que les forces sociales élémentaires soient subjuguées pour que puisse s’établir un jeu harmonien entre les forces naturelles et l’homme. Et de même qu’un enfant qui apprend à saisir tend la main vers la lune comme vers une balle à sa portée l’humanité, dans ses tentatives d’innervation, envisage, à côté des buts accessibles, d’autres qui ne sont d’abord qu’utopiques. Car ce n’est pas seulement la seconde technique qui, dans les révolutions, annonce les revendications qu’elle adressera à la société. C’est précisément parce que cette technique ne vise qu’à libérer davantage l’homme de ses corvées que l’individu voit tout d’un coup son champ d’action s’étendre, incommensurable. Dans ce champ, il ne sait encore s’orienter. Mais il y affirme déjà ses revendications. Car plus l’élément collectif s’approprie sa seconde technique, plus l’individu éprouve combien limité, sous l’emprise de la première technique, avait été le domaine de ses possibilités. Bref, c’est l’individu particulier, émancipé par la liquidation de la première technique, qui revendique ses droits. Or, la seconde technique est à peine assurée de ses premières acquisitions révolutionnaires, que déjà les instances vitales de l’individu, réprimées du fait de la première technique l’amour et la mort aspirent à s’imposer avec une nouvelle vigueur. L’oeuvre de Fourier constitue l’un des plus importants documents historiques de cette revendication.
[4]Abel GANCE, Op. Cit., pp. 100-101.
[5]Séverin-Mars, cité par Abel GANCE, Op. Cit., p. 100.
[6]Alexandre ARNOUX, Cinéma, Paris, 1929, p. 28.
[7]Franz WERFEL, Ein Sommernachtstraum. Ein Film von Shakespeare und Reinhardt, Neues Wiener Journal, cité par Lu, 15 novembre 1935.
[8]Luigi PIRANDELLO : On tourne, cité par Léon PIERRE-QUINT, Signification du cinéma(L’Art cinématographique, II, Paris, 1927, pp. 14-15).
[9]Rudolf ARNHEIM, Der Film als Kunst, Berlin, 1932, pp. 176-177.
[10]Rudolf ARNHEIM, Op. Cit., p. 138.
[11]Il est vrai qu’une analyse intégrale de ces films ne devrait pas taire leur sens antithétique. Elle devrait partir du sens antithétique de ces éléments qui donnent une sensation de comique et d’horreur à la fois. Le comique et l’horreur, ainsi que le prouvent les réactions des enfants, voisinent étroitement. Et pourquoi n’aurait on pas le droit de se demander, en face de certains faits, laquelle de ces deux réactions, dans un cas donné, est la plus humaine ? Quelques-unes des plus récentes bandes de Mickey Mouse justifient pareille question. Ce qui, à la lumière de nouvelles bandes de Disney, apparaît nettement, se trouvait déjà annoncé dans maintes bandes plus anciennes : faire accepter de gaieté de coeur la brutalité et la violence comme des caprices du sort.
[12]L’archétype théologique de ce recueillement est la conscience d’être seul à seul avec son Dieu. Par cette conscience, à l’époque de splendeur de la bourgeoisie, s’est fortifiée la liberté de secouer la tutelle cléricale. À l’époque de sa déchéance, ce comportement pouvait favoriser la tendance latente à soustraire aux affaires de la communauté les forces puissantes que l’individu isolé mobilise dans sa fréquentation de Dieu.
[13]Georges DUHAMEL, Scènes de la vie future, Paris, 1930, p. 52.
[14]Le film représente la forme d’art correspondant au danger de mort accentué dans lequel vivent les hommes d’aujourd’hui. Il correspond à des transformations profondes dans les modes de perception transformations telles qu’éprouve, sur le plan de l’existence privée, tout piéton des grandes villes et, sur le plan historique universel, tout homme résolu à lutter pour un ordre vraiment humain.
[15]Georges DUHAMEL, op. cit., p. 58.
[16]Il s’agit ici de souligner une circonstance technique significative, surtout en ce qui concerne les actualités cinématographiques. A une reproduction massive répond particulièrement une reproduction des masses. Dans les grands cortèges de fête, les assemblées monstres, les organisations de masse du sport et de la guerre, qui tous sont aujourd’hui offerts aux appareils enregistreurs, la masse se regarde elle-même dans ses propres yeux. Ce processus, dont l’importance ne saurait être surestimée, dépend étroitement du développement de la technique de reproduction, et particulièrement d’enregistrement. Les mouvements de masse se présentent plus nettement aux appareils enregistreurs qu’à l’oeil nu. Des rassemblements de centaines de mille hommes se laissent le mieux embrasser à vol d’oiseau et, encore que cette perspective soit aussi accessible à l’oeil nu qu’à l’appareil enregistreur, l’image qu’en retient l’oeil n’est pas susceptible de l’agrandissement que peut subir la prise de vue. Ce qui veut dire que des mouvements de masse, et en premier lieu la guerre moderne, représentent une forme de comportement humain particulièrement accessible aux appareils enregistreurs.














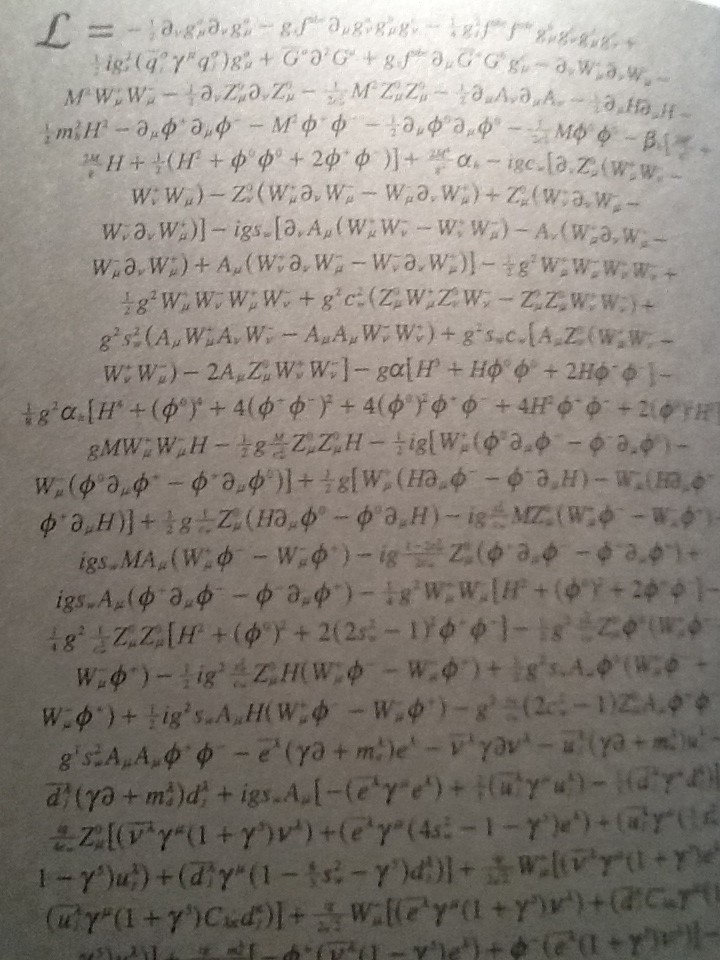




 Bonjour cher Malik,
Bonjour cher Malik,


























 “
“ « Par ece K h’abra has Ta el di Ez y nu eve d’el se Gundo mes.
« Par ece K h’abra has Ta el di Ez y nu eve d’el se Gundo mes.












![Galopperende hest [Cheval au galop], 1910-1912 Huile sur toile, 148 x 120 cm Edward Munch, Galopperende hest [Cheval au galop], 1910-1912 Huile sur toile, 148 x 120 cm](https://disparates.org/escapades/wp-content/uploads/2011/10/photo-e1319366738608-768x1024.jpg)










